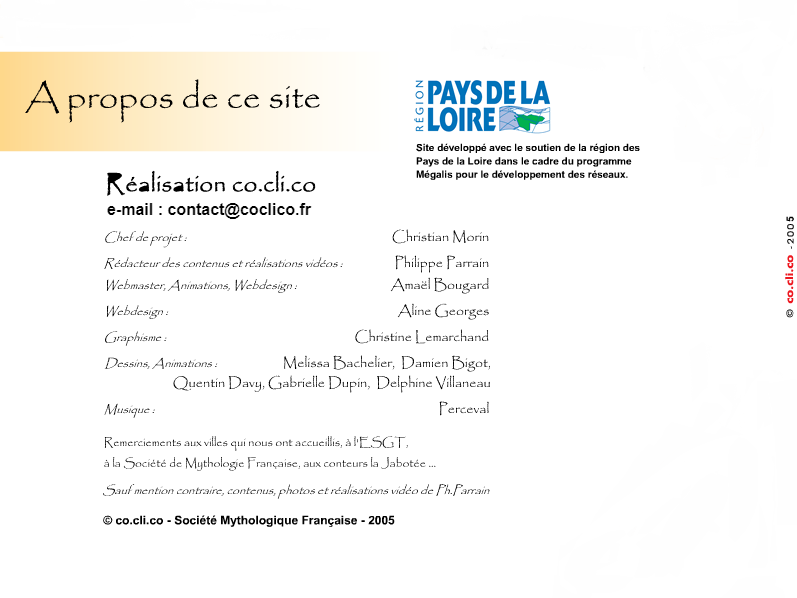
Description
L'Ogre ! Qui n'a pas rêvé de l'ogre dans son enfance et frissonné en imaginant le terrible mangeur de chair humaine ?
Pierre Saintyves
La figure de l'ogre - "homme sauvage qui mangeoit les petits enfans", pour reprendre la définition de Perrault - n'a pas cessé de titiller l'imaginaire. Il n'est que de dénombrer les contes qui lui donnent le beau rôle, les livres pour enfants et les jeux vidéo qui lui sont consacrés, ou d'observer la fascination qu'exercent certains faits divers.
Le cannibalisme nous ramène à un passé réel ou fantasmé, aux fondements mêmes de la civilisation. Ce thème de la dévoration en appelle aux pulsions et aux terreurs les plus élémentaires, qui se virent sublimées par les religions ("Mangez, ceci est mon corps ...") comme par le langage courant ("elle est belle à croquer").
Selon Henri Dontenville, la première trace littéraire de l'ogre se trouve dans les contes de Perrault, puis dans ceux de Mme d'Aulnoy.
On a longtemps considéré que ce mot était une déformation de "Hongrois", en référence aux destructions commises par les Huns. Cette proposition a depuis été contestée, le terme roman pour désigner ces derniers ne pouvant aboutir à une telle transformation.
Il est en réalité plus probable que ce terme découle du latin orcus : Orcus était le dieu étrusque des Enfers, et les Romains adoptèrent son nom pour évoquer l'aspect le plus terrible de Pluton, pourfendeur des malfaiteurs. L'italien en a fait l'orco, le prototype de ce qui deviendra l'ogre de nos traditions populaires.
On a aussi pu faire référence à une divinité grecque Horcus, veillant au respect du Serment et vengeur du Parjure.
Quelle qu'en soit l'origine, le nom de l'ogre, avec ses consonnes GR, renvoie à la racine garg, "gorge", que l'on retrouve dans le nom de nombreux dragons.
 |
 |
L'inquiétante silhouette de l'ogre, du "dévoreur", traverse les mythologies et l'histoire. Homère a immortalisé le cyclope Polyphème : "Il bondit et, jetant les bras sur mes compagnons, en saisit deux d'un coup et les fracassa contre terre comme des chiots ; leur cervelle, en giclant, mouilla le sol. Il les dépeça membre à membre et en fit son repas, les dévorant tel un lion nourri dans les montagnes ; tout y passa : entrailles, chairs et os remplis de moelle." (Odyssée, IX) On connaît bien sûr "le terrible et subtil Kronos" - Saturne, le dieu du temps - qui, pour ne pas être détrôné par ses enfants, les ingurgite dès leur naissance. Il y a aussi Dionysos, "le mangeur de chair crue", qui inspire aux Ménades une folie meurtrière. Et Atrée qui sert à son frère ses deux enfants. Sans oublier Orcus, le dieu des Enfers, qui aurait transmis son nom à l'ogre. Citons encore Ugolin (lequel fut simplement emprisonné et condamné à mourir de faim avec ses enfants, mais dont la mémoire collective s'est emparée pour lui faire dévorer sa progéniture), et Gilles de Rais qui, à sa façon, se régala d'enfants. C'est ce même fantasme qui habite bien des géants (dont Gargantua), dragons, croquemitaines, diables ou loups. On peut le reconnaître avec Gaston Paris dans les râkshasa de la mythologie hindoue, dans les trolls germaniques, ou encore dans le personnage de saint Nicolas (associé à son acolyte/alter ego le Père Fouettard), ou du Père Noël, tous deux représentés, à l'instar de Gargantua, portant une hotte.
L'ogre se définit comme un personnage gigantesque qui se nourrit de chair humaine, et plus spécialement de celle des enfants. Ce sont le plus souvent des êtres frustes, hirsutes et cruels, mais ils peuvent aussi se présenter comme de grands seigneurs, entourés d'une famille et d'une cour. Ils se caractérisent, en plus de leur insatiable voracité, par un odorat particulièrement développé. Ils portent souvent des bottes, éventuellement "de sept lieues", et une hotte qui leur permet d'emmener leur butin. Leur bestialité se double d'un manifeste manque d'intelligence qui permet de les berner et de les contrer.

La mythologie est pleine d'actes de dévoration, individuels ou collectifs, qui expriment alternativement la souveraineté, la vengeance ou la sauvagerie. Mais c'est à un besoin impérieux, à une pulsion incontrôlable que répond l'ogre des contes. L'homme y est soumis à sa bestialité ; il est une gueule vorace, asservie aux exigences d'un tube digestif. Il représente, selon les mots d'Henri Dontenville (Mythologie française, la "valorisation négative, «noire» de Gargan-Gargantua", le soleil celtique». Le personnage de l"ogre, cependant, ne se limite pas à cette sauvagerie : contrairement au loup qui mange la viande crue, il l'apprécie finement cuisinée, et il bénéficie volontiers d'un statut social - château, famille, relations ... - qui suscite la respectabilité.
Balthus Zaminski n'était pas un de ces ogres vulgaires comme on en voit sur les images, au ventre proéminent, aux longues moustaches tombantes, aux vêtements débraillés tachés de sang et de graisse. Non ce n'était pas une de ces brutes carnassières qui poussent des rugissements affreux, c'était un monsieur d'une grande élégance, toujours rasé de près, avec juste des mains un peu fortes et des dents très aiguisées.
Pascal Bruckner, Les Ogres anonymes
L'ogre se décline sur de multiples registres : c'est le loup, le croquemitaine, le vampire ... Mais, au sens propre du terme, c'est lorsque l'homme devient vraiment un loup pour l'homme que l'ogre surgit. On peut ainsi actualiser le thème en parlant de tous les modes d'emprise : l'exercice abusif du pouvoir, le détournement de la religion, la pédophilie, le nazisme ... Ecrivains et cinéastes en proposent maints exemples. On peut observer également, à travers la littérature, une tentative de réhabilitation de l'ogre, une certaine revendication du droit à l'«ogritude», tandis que le petit Poucet tend à endosser, en même temps que ses bottes et ses biens, les traits du prédateur : Perrault nous montre son chat, lui aussi «botté», qui dévore l'ogre transformé en souris. Témoin de l'ambiguïté du symbole, saint Nicolas a pu être interprété comme un ogre, aussi bien que le Père Noël qui, chargé de sa hotte, lui a succédé. Henri Rey-Flaud (Le Charivari, Payot, 1985) voit dans le duo qu'il forme avec le père Fouettard le dédoublement d'un seul personnage plutôt inquiétant. La tradition germanique, notamment, en conserve la mémoire, et le sac ou la hotte apparaissent en ce sens d'utiles accessoires : "Dans toute l'Europe, la fête du bon saint Nicolas est marquée par le surgissement de figures menaçantes, venues quelquefois pour prendre les femmes, mais le plus souvent pour emporter et tuer les enfants." Et ce n'est pas par hasard si les récits mettant en scène des ogres se placent souvent sous le signe de Noël. Comme le petit Poucet, il faut traverser la forêt obscure, se faire avaler par la longue nuit, avant de marcher vers la lumière. Le solstice est un passage périlleux, qui a longtemps suscité peurs et angoisses. C'est la période où l'on voit d'inquiétantes créatures hanter les longues nuits, et ce n'est qu'au sein du foyer retrouvé que l'on peut se sentir en sécurité. La vieille année doit faire place à la nouvelle, il faut que la jeune génération, ayant dépassé l'épreuve («tué le père»), prenne le relais. Dès lors la rencontre avec l'ogre apparaît comme une initiation. Il ne s'agit pas simplement de semer des petits cailloux et de retrouver le chemin du foyer : lorsque le petit Poucet revient à la maison, il doit repartir. Il lui faut se perdre pour de bon, se retrouver face à face avec le monstre, et revenir Autre, avec la peau de l'ogre sur le dos (ou aux pieds, c'est selon ...).