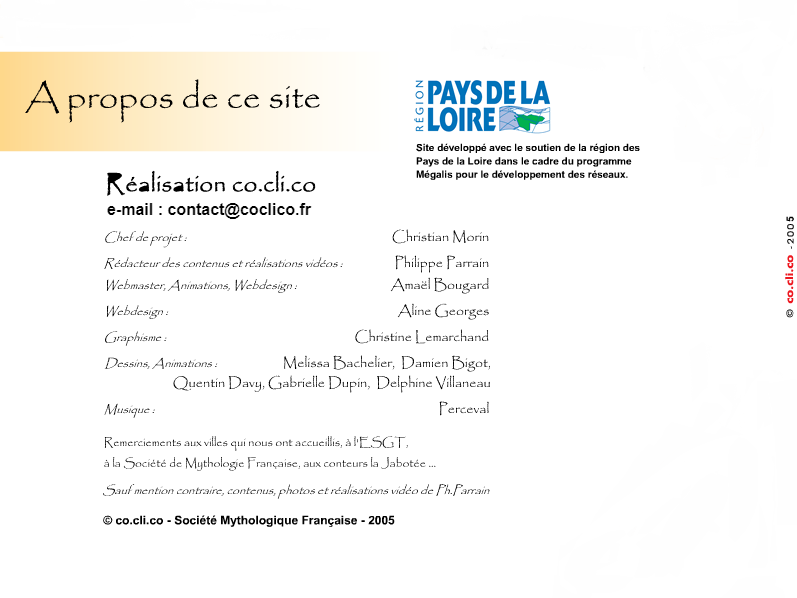
Description
De la racine grecque derk, « brillant », ce qui en fait un être qui « regarde avec intensité et fixité ». Le drakos est à la fois le dragon et le démon.
Les dragons sont souvent désignés sous le terme de « serpent ».
Quelques noms de dragons sont parvenus jusqu'à nous : le Morholt dans la légende de Tristan et Yseut, la Tarasque à Tarascon, la Gargouille à Rouen, le Graouilly à Metz, le Kraulla ou Grand Bailla à Reims, la Grand'Goule à Poitiers, la Chair Salée à Troyes, le Dragon et la Lézarde à Provins, la Velue à La Ferté-Bernard, la Bête Rô à Aytré, le Drac à Beaucaire, Arles, dans le Cantal, le Gers et l'Aude (où chaque rivière cachait un drac), le Lycastre à Porquerolles, le Boeilla à Suippes (51), le Coulobre dans le Gard, le Basilic dans la Vienne et les Charentes, sans oublier Mélusine, la "serpente", qui se retrouve transformée en dragon volant ...
On a parfois identifié la vouivre à un dragon.
 |
 |
Les dragons - "rois des serpents" selon la tradition médiévale - sont des êtres imaginaires qui hantent l'imaginaire de multiples cultures et dont on a longtemps été convaincu de l'existence réelle. Pline en parle dans son Histoire Naturelle, et certains naturalistes continuaient à y croire au XVIIème siècle, confortés par la découverte d'impressionnants ossements de dinosaures. Le bon gardien des temples et des trésors devient, chez les Grecs, un enjeu pour les héros avides de prouesses (Persée), ce qui en retour implique pour le dragon une désacralisation et une diabolisation : c'est le Diable en personne qui se montre à sainte Marguerite sous la forme d'un dragon. Son image s'en est trouvée transformée jusqu'à nos jours ; d'abord révéré, il est devenu l'incarnation du Mal et du paganisme ; de bienfaiteur, il est devenu menace : "Le dragon appartient au monde du passé. Il est le gardien de l'ancienne tradition autochtone vaincue par la nouvelle religion." (Le Dragon en Bretagne, p. 14). C'est toujours un gardien certes, mais sa vocation devient ambiguë de la même façon que les figures des anciens dieux, transmises par la tradition, se sont vues discréditées. Mais les peuples celtiques, attachés aux vieilles traditions, continuent de le considérer positivement : indépendamment du dragon, emblème du roi Arthur, et du drapeau gallois qui s'en revendique, ils lui accordent "une signification de puissance et de fertilité liée à la souveraineté, très proche de la tradition chinoise." (id, p. 18) Si le dragon est une figure bénéfique sous d'autres cieux (en Chine notamment), en France il sème autour de lui la mort et la désolation, dévorant hommes et bêtes (et exigeant souvent un tribut que la société se voit contrainte de lui accorder), suscitant les inondations, brûlant les récoltes, empestant l'air et contaminant les eaux. Il est venimeux, comme le montre le cas du dragon de Niort : terrassé par un soldat condamné à mort, il lui injecte, avant de mourir, son venin qui se montre fatal. Il semble qu'il faille en réalité le considérer comme à la fois bénéfique et maléfique (les inondations ne fertilisent-elles pas le sol, et ne sont-elles pas indispensables malgré les désastres qu'elles provoquent ?) : ils représentent une force terrible et fondamentale qu'on ne saurait nier, mais qu'il est nécessaire de maîtriser, de canaliser, en les détruisant, en les endormant ou en les convertissant. Selon la formulation de Jean Markale (Le Mont-Saint-Michel et l'énigme du dragon) : "Le Dragon (...) représente une potentialité non encore mise en oeuvre et qui, par son aspect instinctif et terrifiant, peut constituer un redoutable danger. Il faut dompter ses forces et les endiguer de façon à enrichir l'humanité de cette potentialité encore vierge." Le dragon, en tant que menace, appelle en effet son antidote, son adversaire : le sauroctone, qu'il soit saint ou simple humain. Mais son antique pouvoir et son caractère lointainement bénéfique ne semblent pas oblitérés dans nombre de cas, où l'on voit le héros non pas éliminer physiquement le dragon, mais l'amadouer, le domestiquer (sauf parfois à laisser la foule l'achever) et le plus souvent simplement assurer sa domination sur lui, en le rejetant en marge de la société humaine, sous un rocher ou au fond des eaux, et en lui intimant de ne plus revenir. Expression des énergies naturelles, le dragon participe des quatre éléments : l'eau d'où il sort et qu'il vomit dans certains cas, la terre (c'est une créature tellurique, chtonienne), l'air dans lequel il s'envole puisqu'il est ailé, et le feu qu'il crache. En alchimie, les dragons représentent les métaux de base avant qu'ils soient transmutés.
 |
 |
J.-L. Borges présente simplement le dragon comme "un gros et grand serpent avec des griffes et des ailes." Mais se description peut varier selon les âges et les auteurs. On peut en noter quelques caractéristiques :
- Au Moyen Age, le dragon perd ses plumes et revêt les ailes membraneuses de la chauve-souris qui hante les profondeurs.
- Il se présente sous de nombreuses formes qui associent de façons variables le corps écailleux et allongé du serpent, les ailes membraneuses de la chauve-souris, les crocs du carnassier, un dard acéré, de petites cornes pointues, une longue queue éventuellement fourchue ; le dragon est parfois apode, ou doté de deux ou le plus souvent quatre pattes munies de puissantes serres. On considère souvent que la seule partie vulnérable de son corps est son ventre mou.
- Il se cache dans les profondeurs de la terre ou de la mer, ce qui ne l'empêche pas de voler, et il vit aussi bien dans le feu que dans l'eau, éléments qu'il peut cracher de façon abondante.
- Il se manifeste par une odeur pestilentielle.
Michel Pastoureau le décrit, en s'inspirant des textes médiévaux, comme "un être hideux et redoutable, le plus grand de tous les serpents dont il possède le poison, la queue et le corps visqueux. Mais son aspect est bien plus effrayant. Il possède sur le dos une crête et des écailles, parfois des ailes qui lui permettent de voler. Ses pattes énormes sont terminées par d'immenses griffes avec lesquelles il déchire ses proies. Sa bouche et ses oreilles crachent du feu, sa langue et sa queue sont fourchues, son corps n'est pas seulement visqueux, mais aussi pustuleux et sent terriblement mauvais. Son regard fixe est terrifiant, et parfois le dragon n'est pas doté d'une seule tête mais de plusieurs. C'est un ogre qui tout à la fois bave, crache, vomit, engloutit, écrase, déchire et dévore. Maître des eaux, que ses colères font déborder, gardien des montagnes et des trésors, il est à la fois violent et rusé, imprévisible et pratiquement invincible : il court plus vite qu'aucun autre animal, rampe sur le sol, sa cache dans les rochers, vole dans les airs, nage sous les eaux, participant ainsi aux trois mondes, terrestre, céleste et souterrain." (Les Animaux célèbres, p. 225)

- Dragons entre sciences et fictions, sous la direction de Jean-Marie PRIVAT, Paris, CNRS Editions, 2006. - Claude LECOUTEUX, Les Monstres dans la littérature allemande du Moyen Age (1150-1350), Gëpingen, 1982. - Claire ARLAUX, Le Dragon en Bretagne, Gourin, Keltia Graphic Editions, 2000. - Patrick ABSALON et Frédérik CANARD, Les Dragons - Des monstres au pays des hommes, Paris, Gallimard, 2006. - Michel MEURGER, Histoire naturelle des dragons, Rennes, Terre de Brume, 2001. - Jean-Paul CLEBERT, Dictionnaire du symbolisme animal, Paris, Albin Michel, 1971. - Michel PASTOUREAU, Les Animaux célèbres, Paris, Bonnneton, 2001. - Jacques LE GOFF, Culture ecclésiastique et culture folklorique au Moyen Age : Saint Marcel et le dragon de Paris, Pour un autre Moyen Age, Paris, Gallimard, 1997. - Michael PAGE et Roger INGPEN, Encyclopédie des monstres qui n'existent pas, Turin, Gallimard, 1987. - Marie-France GUEUSQUIN, Le Mois des dragons, Bibliothèque Berger-Levrault, 1981. - Jurgis BALTRUSAITIS, Le Moyen Age fantastique, antiquités et exotismes dans l'art gothique, Paris, Flammarion, 1993. - Patrick DARCHEVILLE, Du dragon à la licorne, symbolique des animaux fabuleux, Clamecy, Guy Trédaniel, 1994. - Edouard BRASEY, Géants et dragons, Paris, Pygmalion, 2000. - Jorge-Luis BORGES, Manuel de zoologie fantastique, Paris, Christian Bourgeois, 1957. Les dragons au cinéma (Le Fleuve sauvage) : http://www.mythofrancaise.asso.fr/3_nouvel/FleuveSauvage.pdf