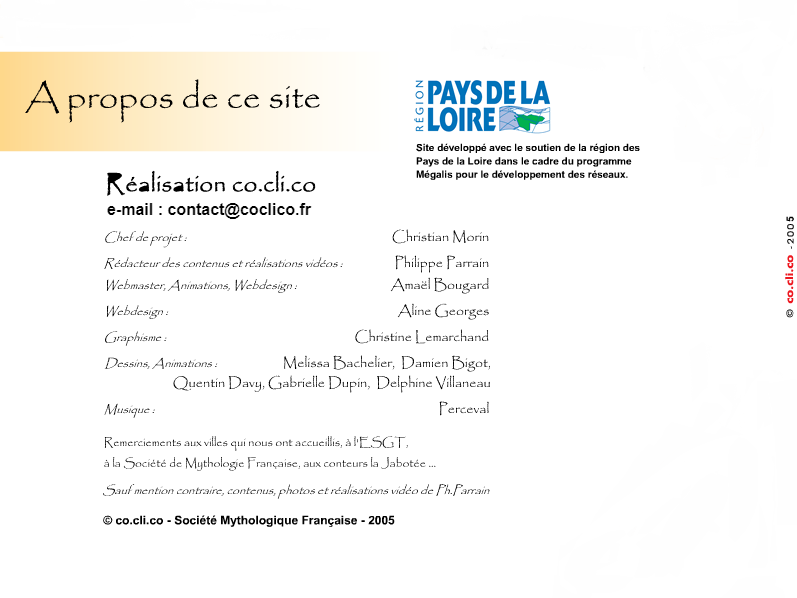
Description
La Sirène est un personnage qui, à travers l'Antiquité, a fait un long chemin pour venir s'acclimater sur nos côtes et sur les chapiteaux de nos églises.
Les Grecs anciens, s'inspirant peut-être de la représentation égyptienne de l'âme, la voyaient comme un oiseau à tête et poitrine de femme (une préfiguration de nos anges ?), qui charmait les navigateurs de leurs chants afin de pouvoir les entraîner au sein des flots et les dévorer. Ce n'est qu'ultérieurement, sous les influences celte et nordique, qu'elle est devenue femme-poisson.
Le Moyen Age, non sans céder à la trouble fascination que continuent d'exercer ses formes et ses chants, lui confère un rôle moralisateur : c'est la figure trompeuse de la tentation. Et sa représentation évoque les périls qui guettent le pécheur (souvent le "pêcheur" dans son bateau) embarqué pour sa traversée vers la vie éternelle. Le Christ est comparé à Ulysse, qui résiste au chant des Sirènes, et le mât auquel il est fermement attaché pour ne pas céder à leur voix, est la Croix à laquelle le chrétien doit s'enchaîner pour ne pas succomber à la tentation : « C'est ainsi que doit faire le sage qui passe à travers le monde : il doit demeurer chaste et pur, et se boucher les oreilles, afin de ne pas entendre des paroles qui puissent le conduire au péché. » (Guillaume Le Clerc, Bestiaire divin, XIIIème siècle)
Au fil des siècles, son caractère monstrueux fait place à un aspect plus doux voire protecteur (ce sont des sirènes qui guidaient les âmes vers le royaume des morts), et sa séduction, de cruelle, devient sensuelle et presque moralement désirable, avant que sa figuration devienne essentiellement ornementale et symbole de protection, gardienne de la mer (proues des navires, armoiries ...).
Dans les contes, la Sirène est souvent assimilée à une fée des rivages, et apparaît le plus souvent sous un jour bienveillant, à moins que l'on ne cherche à lui nuire ou qu'on lui manque de parole, auxquels cas elle peut se montrer terrible. Mais elle peut aussi, dans certains cas, déclencher de violentes tempêtes.
On a longtemps cru en l'existence réelle des Sirènes, et on les a fait figurer parmi les animaux marins, entre le crabe et la langouste. Christophe Colomb, entre autres, en croisa sur les mers, et - confusion avec certains animaux comme les lamantins ou simple supercherie - les savants en observèrent jusqu'au XVIIIème siècle et en disséquèrent. Certains spécimens furent même exposés au public, par exemple par Barnum.
Le mot "Sirène" viendrait du grec seirazein, "attacher avec une corde, lier", et c'est bien ainsi que l'on peut définir les sortilèges dont elles enchaînent les marins.
Une étymologie possible a été proposée (dictionnaire Roscher) qui ferait de la Sirène « celle qui étouffe ».
L'attraction se fait plus tard avec le mot « serein, sereine », évoquant le charme qui émane de son aspect et la suavité de ses chants. Au Moyen Age, on ne parlait plus de « Sirènes », mais de « seraines »
 |
 |
Nombreuses divinités qui, à travers le monde, arborent une queue de poisson et/ou qui, émanation de la mer, exercent leur séduction sur les hommes : Echidna, Scylla, Oannès, Atargatis, Derceto, Aphrodite/Vénus, Mélusine (Jean d'Arras qualifie celle-ci de Sirène lorsqu'elle est surprise au bain), la Lorelei ... Les esprits qui habitent les eaux : Océanides, Néréides, Naïades, Tritons, Harpies, Muses, Ondines, Nixes, Mermaids, Mari-Morganes bretonnes ...
 |
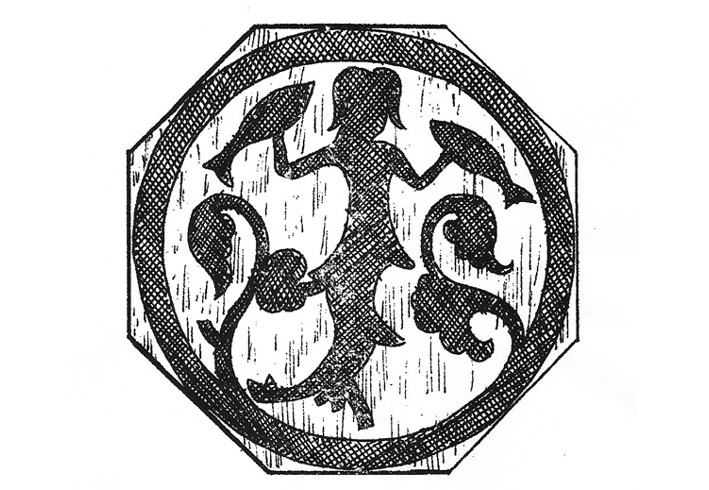 |
- HOMERE, L'Odyssée, chant XII, IXème siècle av. J.-C.
- Apollonios de Rhodes, Les Argonautiques, IIIème siècle av. J.-C.
- G. KASTNER, Essai sur les principaux mythes relatifs à l'incantation, les Sirènes, Paris-St-Pétersbourg, Brandus et Dufour, 1858.
- Vic de DONDER, Le Chant de la Sirène, Gallimard, 1992.
- Edouard BRASEY, Sirènes et ondines, Paris, Pygmalion, 1999.
- Michel BULTEAU, Les Filles des eaux, Editions du Rocher, 1982.
- Adeline BULTEAU, Les Sirènes, Puiseaux, Pardès, 1995.
- Silla CONSOLI, Le Mythe de la Sirène : variantes, fantasmes, sous-jacents et implications psychopathologiques, thèse, Université de Paris VI, 1973.
- Silla CONSOLI, La Candeur d'un monstre, Le Centurion, 1980.
- Yves LE DIBERDER, Contes de sirènes, Rennes, Terre de Brume, 2000.